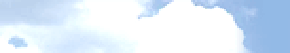|
 |
 |
 |
Historique
: |
|
| |
(réalisé
avec l'ouvrage de Jean Michel Belorgey : Cent ans de
vie associative (Presse de Sciences PO ) et le rapport
du Conseil d'Etat 2000 sur la vie associative. cf bibliographie
 L'association
n'est pas née avec la loi de 1901. L'association
n'est pas née avec la loi de 1901.
En effet le groupement de personnes dans un but
d'action collective, de réflexion, d'échanges ou de
partage religieux... a toujours fait partie de l'activité
humaine : depuis l'Antiquité avancent certains historiens
; au moins depuis le Moyen Age Occidental comme en témoignent
des documents écrits qui font état d'associations monastiques,
confréries, jurandes ou autres compagnonnages ...
Cette propension humaine à constituer des structures
collectives -permanentes ou non -de type confessionnel,
organisationnel ou professionnel a tendance à
se développer au fur et à mesure des progrès
de la civilisation d'une part, des besoins d'action
collective d'autre part.
Ainsi la fin du 18e siècle et tout le 19e siècle,
caractérisés par la naissance et le développement
de l'industrialisation et de l'urbanisation avec leur
corollaire socio-politique qu'est la lente organisation
du mouvement ouvrier, vont constituer le terreau des
sociétés mutuelles d'entr'aide, des coopératives
et autres associations créées pour soulager
la misère des employés des manufactures,
faire valoir leurs droits et faire avancer le droit
social.
Mais il est évident que ces "rassemblements"
ou sociétés ont très souvent suscité
la méfiance des pouvoirs en place et notamment
de la Monarchie absolue à compter de l'époque
moderne (17et 18e siècle) comme de l'Empire .
| Deux
éléments inquiétèrent
les autorités intellectuelles et politiques
dans le processus d'association : |
| •
d'une part, la dérive vers une possible dépossession
de la liberté individuelle allouée à chaque citoyen
lors de sa naissance |
•
d'autre part, la dimension subversive ou fractionnelle
que peuvent représenter des groupements intermédiaires
entre le citoyen et l'Etat-nation ainsi que
le danger de désordre public qu'ils peuvent
constituer |
 C'est le premier motif de méfiance que retiendront
particulièrement les "Lumières"
du 18e siècle, voyant dans l'association, un
frein à l'épanouissement du libre arbitre,
un écran au contrat social passé entre
le citoyen et l'Etat Nation (Rousseau), comme le feront
les premiers Constituants de 1789 à 1797 en décidant
de dissoudre les assemblées populaires, les clubs
et autres sociétés politiques .
C'est le premier motif de méfiance que retiendront
particulièrement les "Lumières"
du 18e siècle, voyant dans l'association, un
frein à l'épanouissement du libre arbitre,
un écran au contrat social passé entre
le citoyen et l'Etat Nation (Rousseau), comme le feront
les premiers Constituants de 1789 à 1797 en décidant
de dissoudre les assemblées populaires, les clubs
et autres sociétés politiques .
Sous couvert de libérer compagnons et apprentis
du joug d'un regroupement contraint, la Constituante
avait, dès le 14 Juin 1791, par la Loi le Chapelier,
interdit les associations de corporations.
 Puis
s'ouvrira le 19ème siècle, sous les auspices
du Code Pénal de 1810 (article 291) qui dispose expressément
que : Puis
s'ouvrira le 19ème siècle, sous les auspices
du Code Pénal de 1810 (article 291) qui dispose expressément
que :
" nulle association de plus de 2O personnes, dont
le but sera de se réunir tous les jours ou à certains
jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires
politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément
du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira
à l'autorité politique d'imposer . "
 Ces dispositions resteront en vigueur sous la Restauration
et sous la Monarchie de Juillet. Le seul intermède sera
la Seconde République dont la Constitution du 4 Novembre
1848 dans son article 8 reconnaît aux citoyens :
Ces dispositions resteront en vigueur sous la Restauration
et sous la Monarchie de Juillet. Le seul intermède sera
la Seconde République dont la Constitution du 4 Novembre
1848 dans son article 8 reconnaît aux citoyens :
" le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement
et sans arme, de pétitionner, de manifester leurs pensées
par voie de presse ou autrement "
C'est donc dans un contexte pénal et avec une préoccupation
principale d'ordre public que le 19e siècle va voir
se développer et se conquérir progressivement un droit
d'association qui aboutira finalement à la promulgation
de la loi du 1er Juillet 1901.
|
 |
•
1852 |
| |
| loi
sur les sociétés de secours mutuel (à l'époque
où les premiers ouvriers connaissent les rigueurs
des conditions de travail dans les premières manufactures
de la première ère industrielle |
|
|
•
Loi du 24 Juillet 1868 sur les coopératives |
|
•
Loi du 6 Juin 1868 sur les réunions publiques (sous réserve
de déclaration préalable) |
| |
•
IL faudra attendre ensuite les lois du 12 Juillet 1875
et du 21 Mars 1884 pour que soient soustraits aux rigueurs
de l'article 291 du Code Pénal : |
| |
| -
les associations formées pour créer
et entretenir des cours ou établissements
d'enseignement supérieur (1875)
- les syndicats professionnels ayant pour seul
objet " la défense des intérêts
économiques, industriels, commerciaux et
agricoles "
Par cette loi de 1884, les syndicats acquièrent
la personnalité morale ester en justice,
acquérir des biens, meubles et immeubles,
créer des sociétés de secours
mutuel et des coopératives |
|
| |
 Ces
premiers textes vont desserrer l'étau mis en
place au début du siècle et permettre
la naissance de multiples " sociétés
" surtout dans les domaines de l'assistance aux
personnes, des oeuvres charitables, l'organisation du
travail mais aussi dans les secteurs du sport où
les premières associations voient le jour à
l'image des clubs anglais ou germaniques. Ces
premiers textes vont desserrer l'étau mis en
place au début du siècle et permettre
la naissance de multiples " sociétés
" surtout dans les domaines de l'assistance aux
personnes, des oeuvres charitables, l'organisation du
travail mais aussi dans les secteurs du sport où
les premières associations voient le jour à
l'image des clubs anglais ou germaniques.
De
ces avancées progressives naîtront les
projets des députés Brisson, Groussier,
et Pierre Waldeck Rousseau à partir des années
1880 en faveur d'une loi cadre destinée à
faire admettre un texte de portée générale
sur le droit de s'associer librement .
On
ne compte pas moins de trente projets ou propositions
de texte dont trois importants en 1883, 1888 et 1889
dans les deux dernières décennies du siècle.
Les historiens s'accordent à dire que le principal
frein à l'aboutissement de ces projets, pourtant
bien introduits dans l'esprit par la loi relative aux
syndicats de 1884, fut le climat passionnel né
des relations conflictuelles entre l'Eglise et l'Etat
en cette fin de siècle.
En effet, les tenants de la laïcité, même
s'ils soutenaient l'idée d'un droit très
large à l'association craignaient de voir proliférer
encore les nombreuses congrégations religieuses,
constituées en associations et jouissant de droit
de main-morte, c'est à dire d'éléments
de patrimoine foncier et ou bâti donnés
en dons et legs aux personnalités morales qu'elles
constituaient.
C'est ainsi que le texte finalement voté en 1901
interdit les dons et legs -autres que manuels-aux associations
telles que définies dans l'article 1 de la Loi
et réserve ce privilège aux associations
reconnues d'utilité publique et donne naissance
au " contrat associatif " que l'on connaît
aujourd'hui, librement conclu entre des personnes qui
le souhaitent et qui "déclaré"
acquiert la capacité d'ester en justice, de contracter
et de recevoir des cotisations.
Les associations "cultuelles" seront définies
après la loi du 9 Décembre 1905 organisant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat et remplaceront les établissements
publics du culte du régime du Concordat .
| Cette
loi 1901, concise, précise et courte ne connaîtra
que 2 modifications importantes : |
| •
en 1939 (décret loi du 12 avril) qui modifie le
régime des associations étrangères en les soumettant
à autorisation et en réputant étrangère toute association
ayant des administrateurs étrangers ou un quart
de ses membres étrangers |
| •
en 1981 (loi du 9 octobre 1981) qui abrogera les
dispositions de la loi de 1939 sur les associations
" étrangères " |
 Enfin,
le 16 juillet 1971, une Décision du Conseil d'Etat porte
la liberté d'association telle que définie par la loi
1901 au rang des libertés constitutionnelles. Enfin,
le 16 juillet 1971, une Décision du Conseil d'Etat porte
la liberté d'association telle que définie par la loi
1901 au rang des libertés constitutionnelles. |
|
|
 |
 |
|